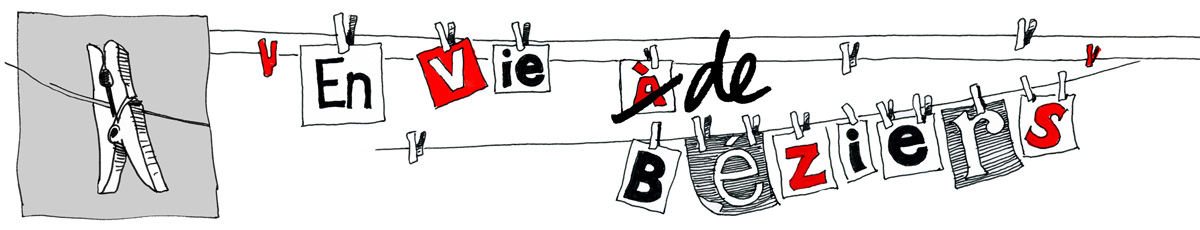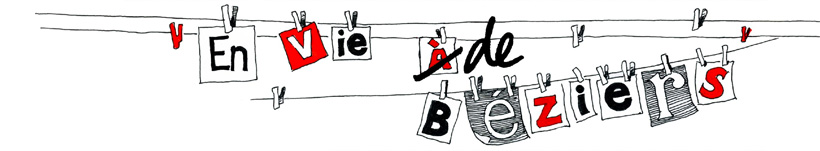C’est donc le 18 octobre que les insurgés, faute de munitions, renoncent. Ils signent leur reddition avec le général Lopez Ochoa. Le bilan est lourd : plus de 2 000 tués, 3 000 blessés et 15 000 prisonniers ou déportés.
S’ensuit une répression atroce, impitoyable, impressionnante et sanglante. Et la répression se chiffre, c’est son horreur. Elle se détaille également, et c’est son abomination. Elle ne s’arrête pas aux seuls insurgés mais touche toute la population. La police justifiant cette sanglante opération en prétextant un armement important des mineurs (90 000 fusils, 33 000 pistolets, 330 000 cartouches, 10 000 caisses de dynamite et 30 000 grenades), alors que les fusils des insurgés n’avaient pratiquement pas de munitions.

On déclare l’état de guerre pour trois mois. On condamne à mort sans discernement. Alors que tout est perdu hors l’honneur pour les insurgés, on fusille, au petit malheur la chance, des hommes suspectés d’avoir porté des armes, dans les bassins miniers. Le gouvernement Lerroux- Roblès cogne, et il cogne à tour de bras. Après la reddition d’Oviedo, une chasse à l’homme est menée à l’échelle d’une région, voire au-delà, vers les montagnes frontalières du León, où des groupes communistes continueront une guérilla.
On constitue des départements de tortionnaires, dirigés par Doval, commandant de la garde civile, qui restaure les vieilles pratiques de l’Inquisition. La sauvagerie des interrogatoires, infligée aux prisonniers suscite une réprobation sitôt qu’elle est rendue publique, non sans bravoure, par Alvarez del Vayo, journaliste de la gauche socialiste et futur ministre du Front populaire. Pour le commandant Doval, supplicier à l’ancienne – il révèle les agissements généralisés par la SS et la Gestapo –, c’est, sans aucun doute, sacrifier à une tradition. Le scandale est si grand que le gouvernement ne peut l’assumer. Duval est révoqué et s’exile.
 La frousse des classes dirigeantes est telle que le gouvernement n’hésite pas. Les Asturies paieront un prix élevé. On prononce des peines de prison extravagantes. On exécute le sergent Vazquez, coupable d’avoir rejoint un détachement ouvrier. Manuel Azaña, l’ancien président du Conseil, est incarcéré bien qu’il n’eût pas participé aux événements. Les députés socialistes Gonzalez Peña et Teodomiro Menéndez, sont condamnés à la peine capitale. Largo Caballero, dirigeant de l’UGT, Santiago Carrillo, secrétaire des Jeunesses socialistes, sont incarcérés. Lluis Companys, président de la généralité de Catalogne, est promis à trente ans de bagne. Aucune condamnation à mort ne sera prononcée à la suite des événements survenus en Catalogne. Aux Asturies, l’hémorragie confine au vertige, et c’est en cela, surtout, que les Asturies préviennent la future guerre d’Espagne.
La frousse des classes dirigeantes est telle que le gouvernement n’hésite pas. Les Asturies paieront un prix élevé. On prononce des peines de prison extravagantes. On exécute le sergent Vazquez, coupable d’avoir rejoint un détachement ouvrier. Manuel Azaña, l’ancien président du Conseil, est incarcéré bien qu’il n’eût pas participé aux événements. Les députés socialistes Gonzalez Peña et Teodomiro Menéndez, sont condamnés à la peine capitale. Largo Caballero, dirigeant de l’UGT, Santiago Carrillo, secrétaire des Jeunesses socialistes, sont incarcérés. Lluis Companys, président de la généralité de Catalogne, est promis à trente ans de bagne. Aucune condamnation à mort ne sera prononcée à la suite des événements survenus en Catalogne. Aux Asturies, l’hémorragie confine au vertige, et c’est en cela, surtout, que les Asturies préviennent la future guerre d’Espagne.
Les corps engagés par le gouvernement comptabilisent deux cent vingt pertes.
Au total, avec les victimes des combats et de la répression, le nombre de morts atteint les 5.000, auxquels il faut ajouter 7.000 blessés et 30.000 prisonniers.
Cette défaite et la répression qui suivit ne brisa pas pour autant la classe ouvrière asturienne, ni espagnole.
C’est une nouvelle étape du combat politique qu’empruntent alors les événements. Libérer les prisonniers, recouvrer des libertés, poursuivre l’agitation, reconsidérer la stratégie, examiner le bien-fondé des méthodes sont des thèmes à l’ordre du jour. Quelque chose évolue dans le paysage politique espagnol. Les laissés-pour-compte de la République, ouvriers, paysans, employés, les sans-travail, les expulsés, les métayers catalans, les pauvres saisis pour dettes s’identifient au sort des insurgés asturiens. Et ce qui n’avait pas été obtenu par les directives de grève générale et d’insurrection va l’être, paradoxalement, par la défaite : une base de masse plus cohérente se constitue et réalise, vaille que vaille, une communauté volontaire.
Battre une bourgeoisie qui brigue l’arrogance et massifie le crime, étouffer un fascisme protéiforme, renverser les institutions conservatrices, rétablir une morale civique deviennent des impératifs catégoriques des organisations ouvrières et, plus largement, des partis républicains de la gauche modérée. 
Dans les rues, retentit le slogan asturien clamé par des milliers, des dizaines de milliers et un demi-million de personnes à Madrid : UHP ! (Unidos Hermanos Proletarios).
Le Front populaire est en marche, et aucun replâtrage parlementaire ne paraît digne de considération. Les Asturies ont cimenté les gauches espagnoles. On assiste à ce double paradoxe : d’une part, la droite unie au centre et appuyée par l’armée se révèle incapable de gérer sa victoire et ses lendemains encombrants; de l’autre, la gauche qui ne baisse pas les bras. Elle sublime sa défaite et se revitalise. Elle adopte une stratégie d’ensemble susceptible de dynamiser ses forces.
À droite, la victoire remportée aux Asturies défoule.
On promeut les généraux s’étant illustrés lors de l’affaire asturienne. Tous, sans exception, conduiront le coup d’État de 1936. Franco devient chef d’état-major de l’armée; Fanjul, sous- secrétaire d’État à la Guerre; Goded, inspecteur général de l’armée; Mola, commandant en chef des troupes du Maroc ; et Yagüe, qui s’était particulièrement distingué sur le terrain, reçoit le commandement de la 2e l é gion du Te r c i o.
Le 16 février 1936, le Front Populaire dont le programme prévoit notamment la libération des prisonniers politiques détenus depuis la Révolution asturienne de 1934 remporte les élections. Dès le 17 juillet 1936, Francisco Franco, Emilio Mola, José Sanjurjo, Manuel Goded, Joaquín Fanjul et plusieurs généraux nationalistes tentent un coup d'État qui provoquera la Guerre d'Espagne.
La classe ouvrière allait se dresser unanime contre cette tentative d'un nouveau coup d'État militaire, dirigé par les généraux qui avaient été les bourreaux des travailleurs asturiens.
Et si une fois de plus la classe ouvrière fut vaincue, et cette fois-ci pour toute une période historique, les causes de cet échec furent fondamentalement les mêmes que celles de la défaite d'octobre 1934: l'absence d'une direction révolutionnaire à la hauteur de la combativité, de l'héroïsme du prolétariat espagnol.
Alors, 90 ans plus tard, le meilleur hommage que l'on puisse rendre à «ceux d'Oviedo», c'est de retenir les leçons de leur combat et de continuer à lutter pour le monde dont ils rêvaient.
(Fin)