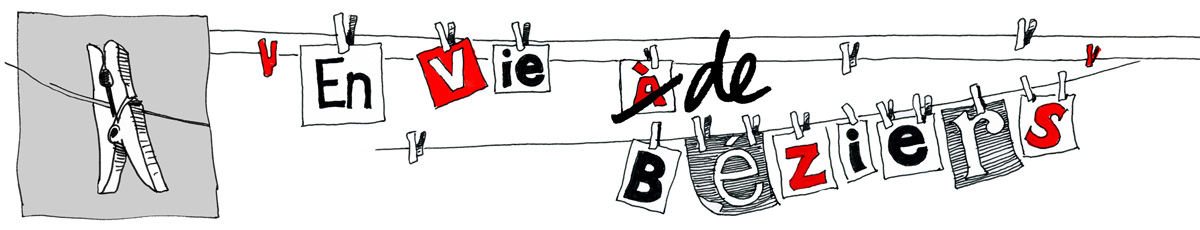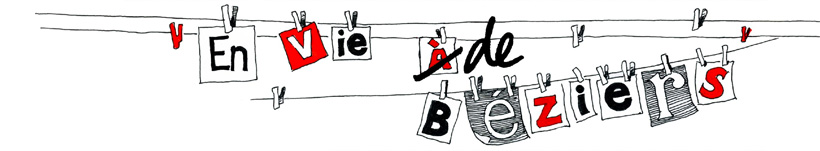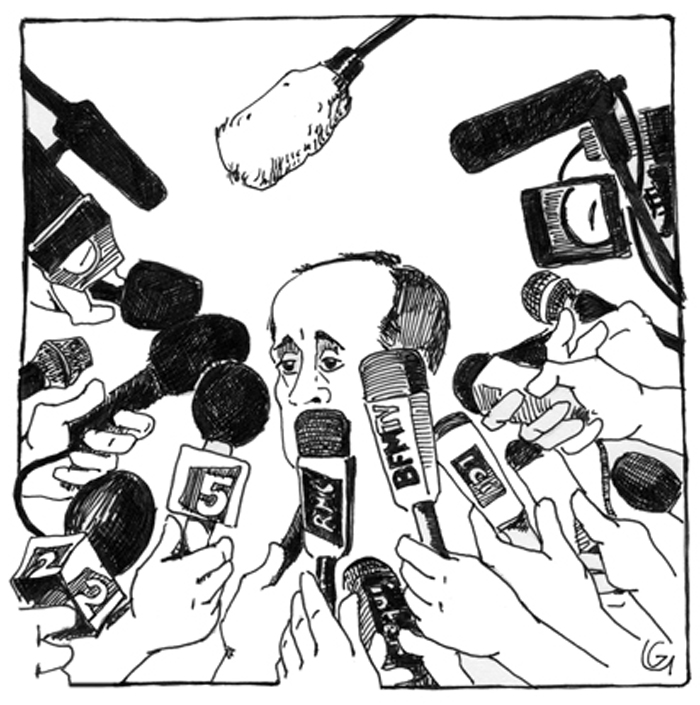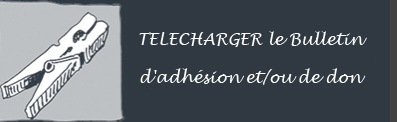Avec la fin du régime républicain et la création de l’État fasciste du maréchal Pétain, Dorgères a pu croire qu’une brillante carrière l’attendait. Ça n’a pas été le cas.
Après juin 1940, tout ce pour quoi avait lutté Dorgères semble se réaliser :
- Le régime parlementaire et les partis politiques honnis sont balayés,
- Les grands ennemis, la gauche et les intellectuels sont réduits au silence,
- Avec les difficultés de ravitaillement, les citadins viennent humblement dans les campagnes,
- La « Révolution nationale » du maréchal Pétain crée un régime autoritaire avec pour piliers la famille et le métier.
Le métier d’agriculteur est d’ailleurs encensé par Pétain qui déclare : « Il faut que le paysan soit hautement honoré, car il constitue avec le soldat les garanties essentielles de l’existence et de la sauvegarde du pays. ».
Dans des conditions qu’il estime hautement favorables, Dorgères espère que Pétain va faire appel à lui.
Le 15 octobre 1940, il écrit au chef de cabinet de Pétain : « je crois être à l’heure actuelle l’homme qui a le plus de contact avec la paysannerie, mais aussi avec la population des villes de province, grâce à mes organisations en zone libre et en zone occupée. »
Ses efforts pour obtenir une place éminente dans le nouvel État pétainiste sont modestement récompensés. Le 24 janvier 1941, il est nommé membre du Conseil national (l’assemblée de notables qui devait aider Pétain à rédiger la nouvelle constitution) et obtient la francisque sous le numéro 153.
La direction de la « Corporation paysanne » crée par la loi du 2 décembre 1940 lui échappe au profit de deux adversaires pronazis, Louis Salleron et Rémy Goussault.
Le 21 janvier 1941, il devient toutefois un des 9 directeurs de la Commission d’organisation corporative (COC).
La véritable direction de la COC est tenue par l’ancêtre de la FNSEA, l’UNSA.
Fin 1941 - début 1942, il veut créer l’insigne de la Corporation paysanne une francisque avec une grappe de raisin et une gerbe de blé surimprimées, mais il est mis en minorité.
À son grand désappointement, la Corporation paysanne ne l’autorise pas à nommer un délégué à la propagande dans chaque commune.
Les autres dirigeants corporatistes se méfient du côté « électron libre » de Dorgères qui de fait propose un fascisme de base plutôt qu’un fascisme étatique.
Dès 1943, la Corporation devient une machine administrative détestée par les paysans qui veille à l’approvisionnement des villes affamées et surtout à la satisfaction des exigences allemandes.
Malgré cela, en bon fasciste discipliné, Dorgères exhorte ses partisans à « travailler sans discutailler » et à manifester « une foi aveugle » dans le maréchal.
Pour lui, la défaite a permis à la France de faire « une révolution sans émeute », d’où va naître une « France paysanne », libérée de l’influence des juifs, des francs-maçons et des communistes.
Pire, il déclare que le rêve paysan de paix et de prospérité est en passe de se réaliser grâce à la collaboration avec l’Allemagne.
Après le débarquement en Afrique du Nord, Dorgères exhorte les paysans à « n’écouter qu’une seule voix, celle du Maréchal Pétain », à « le suivre aveuglément ».
En juin 1944, quand les alliés sont en Normandie, Pétain reste à ses yeux « le seul chef ». « C’est seulement en lui obéissant que l’on évitera la guerre civile ».
Matériellement ? les années de collaboration de Vichy sont très confortables pour Dorgères. Il vit comme les notables qu’il vilipendait dans ses « meetings ruraux ».
À la fin de 1944, Dorgères devient un réfugié et un paria, il sera jugé par le nouveau gouvernement gaulliste.
L’idéal dorgériste d’une profession organisée et maîtresse de ses propres affaires va se formaliser avec la cogestion de l’agriculture entre gouvernement et FNSEA.
En revanche son idéal de détacher la paysannerie de la République au profit d’un régime autoritaire va échouer.
Après la guerre, les paysans ne pratiquent plus l’action directe pour faire tomber un gouvernement, mais le font céder et obtiennent des satisfactions.
Dans le dernier épisode de cette série, la semaine prochaine, R. O. Paxton rendra compte du legs laissé par le dorgérisme aux agriculteurs modernes.